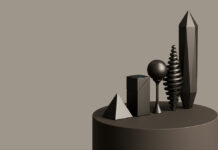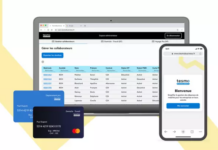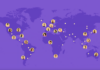Alors que l’Assemblée nationale a approuvé l’augmentation de la (DST) destinée aux géants de la Tech — notamment américains — de 3% à 6%, le gouvernement met en garde contre une possible riposte des États-Unis. Cette mesure reflète la tension croissante entre souveraineté fiscale et compétitivité internationale dans un contexte budgétaire difficile.
Les députés français ont voté le 29 octobre 2025 au soir une série d’amendements à la loi de finances 2026, incluant le doublement de la taxe sur les services numériques, qui passe de 3% à 6% pour les entreprises du numérique concernées.
La mesure vise les sociétés générant désormais un chiffre d’affaires mondial d’au moins 2 milliards d’euros. Le seuil a été relevé par rapport à l’ancien plan de 750 millions d’euros, afin de cibler les plus grands acteurs mondiaux.
Le gouvernement, par la voix du ministre de l’Économie Roland Lescure, a mis en garde : cette montée en charge «pourrait violer des accords internationaux et dégrader l’attractivité de la France». Washington a réagi avec scepticisme. Selon des représentants américains, la mesure cible prioritairement les entreprises Tech américaines — un motif classique de tension transatlantique.
Pour la France, cette mesure intervient dans un contexte de forte pression budgétaire et d’érosion de la confiance des entreprises. La taxation accrue des «big tech» apparaît comme un levier pour dégager des ressources tout en affermissant la souveraineté fiscale numérique.
Mais les enjeux sont nombreux : le risque de représailles commerciales de la part des États-Unis, déjà évoqué dans des cas similaires. La perception d’un cadre fiscal instable qui peut freiner l’investissement étranger. Le débat sur la légitimité d’une taxe basée sur le revenu plutôt que sur le profit, critiquée par plusieurs cabinets d’analyse.
En conclusion, la montée de la DST en France symbolise un tournant dans la régulation des grandes plateformes numériques. Elle marque une volonté de redistribution et de taxation accrue, mais elle expose aussi la France à des répliques économiques et diplomatiques. Le chemin vers un consensus européen ou international reste incertain, et les entreprises des Chambres bilatérales devront surveiller de près les retombées.